|
EN BREF
|
Le CNRS a récemment publié son deuxième bilan carbone pour l’année 2022, permettant une évaluation précise de son impact environnemental. Les émissions de gaz à effet de serre s’élèvent à 14,7 tonnes de CO₂ équivalent par agent, soulignant à la fois les progrès réalisés dans le cadre de son plan de transition bas carbone initié en 2019, ainsi que les biais méthodologiques à corriger. Ce bilan met l’accent sur l’importance de suivre l’impact des achats durables et de continuer à réduire l’empreinte carbone de l’organisme à travers diverses initiatives.
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) a récemment présenté son second bilan carbone, une initiative cruciale pour évaluer et réduire son impact environnemental. Après un premier rapport publié en 2019, ce second bilan pour l’année 2022 vise à définir de manière plus précise les émissions de gaz à effet de serre générées par ses activités. Avec des émissions qui s’élèvent à 14,7 tonnes de CO₂ équivalent par agent, les résultats mettent en lumière les progrès réalisés grâce au plan de transition bas carbone, tout en soulignant les biais méthodologiques à corriger pour mesurer la valeur des achats durables. Ce bilan se veut un outil de sensibilisation et d’action en vue d’améliorer l’évaluation environnementale.
Un processus d’évaluation bien défini
Le CNRS, en réalisant ce bilan carbone, s’inscrit dans une démarche rigoureuse d’évaluation de ses émissions de gaz à effet de serre (GES). Le processus a été initié en 2019 avec le premier bilan, et l’objectif principal était d’analyser les résultats du plan de transition établi pour réduire l’empreinte environnementale de l’organisme. En 2022, l’évaluation a été élargie pour prendre en compte des sources d’émissions qui n’avaient pas été prises en considération lors du premier exercice, notamment les achats de mobilier et les frais liés au transport.
Les grandes lignes du bilan carbone 2022
Le bilan carbone 2022 a révélé que les émissions des activités du CNRS s’élevaient à 14,7 tonnes de CO₂ équivalent par agent. Cette augmentation par rapport à 2019, où les émissions étaient de près de 14 tonnes, s’explique principalement par l’élargissement du périmètre d’évaluation. En effet, le nouveau bilan a inclus des sources d’émission particulières, telles que le mobilier, les frais de transport, et les matériels de transport, permettant ainsi d’obtenir un aperçu plus complet de l’empreinte carbone de l’organisme. Cette évaluation permet de mesurer les résultats d’un plan de transition bas carbone qui a connu plusieurs avancées significatives depuis 2019.
L’importance des achats dans le bilan carbone
Un des constats majeurs du bilan 2022 est que les achats représentent 85% des émissions de GES du CNRS. Cela souligne l’importance des décisions d’achat dans la stratégie de réduction des émissions. À périmètre égal par rapport à 2019, les émissions liées aux achats ont connu une hausse de 3%. Cette augmentation peut être attribuée à des achats non-immobilisés tels que les consommables et les instruments de laboratoire, qui dépendent largement des succès des scientifiques dans les appels à projets. De plus, l’évaluation des émissions liées aux achats s’appuie actuellement sur des ratios monétaires, ce qui limite la précision des calculs. L’absence de données quantitatives exploitables sur les achats rend difficile la distinction entre les choix écoresponsables et ceux plus polluants.
Les défis méthodologiques à surmonter
Le mode de calcul utilisé pour estimer les émissions liées aux achats présente des limites. Il repose sur des ratios monétaires qui ne tiennent pas compte de la réalité des spécificités environnementales des produits. Pour pallier cette absence de données physiques sur les achats, le CNRS utilise un module d’évaluation des achats développé dans le cadre du groupement de recherche Labos 1Point5, permettant d’associer des facteurs d’émission aux différents codes NACRE, mais sans vraiment permettre de différencier les produits en termes d’impact carbone. Cela reste une méthode utile mais imparfaite.
Engagement et initiatives pour des achats durables
Malgré ces défis méthodologiques, le CNRS a pris des mesures pour réduire l’impact environnemental de ses achats. Dès juin 2023, l’organisme a conditionné ses appels d’offres à l’intégration de critères environnementaux, bien avant l’échéance légale imposée par la fonction publique. Ce faisant, il s’est engagé à promouvoir des pratiques d’achats publiques socialement et écologiquement responsables, tout en prévoyant d’achever son premier schéma à cet égard d’ici 2024. De plus, à l’échelle locale, certains laboratoires ont commencé à mutualiser leurs équipements et à établir des magasins pour les consommables, afin de réduire les achats individuels et donc l’impact environnemental.
Succès dans la transition énergétique
La transition vers un modèle énergétique plus durable a également été l’un des axes stratégiques du CNRS. Grâce à des travaux de rénovation importants sur ses infrastructures, l’organisme a réussi à diminuer de 6% sa consommation énergétique totale. Cela inclut une réduction de 10% pour le gaz, 14% pour les réseaux de chaleur, et 16% pour le fioul, ce qui témoigne des progrès réalisés grâce à l’application de son plan de transition bas carbone. Ces efforts visent à améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments et à intégrer des pratiques plus durables dans les opérations quotidiennes du CNRS.
Évolution des déplacements domicile-travail
Les déplacements domicile-travail des agents du CNRS ont également enregistré des améliorations notables. En 2022, la part des véhicules motorisés dans les déplacements quotidiens a diminué de 10%, tandis que les mobilités actives telles que la marche et le vélo ont gagné en popularité, passant à 37% des déplacements. Ce changement des habitudes de transport fait partie intégrante de l’engagement des agents en faveur de pratiques plus durables. De plus, cette évolution apparaît également dans les résultats du challenge national « Mai à vélo », qui a démontré l’adhésion des équipes à une utilisation accrue des mobilités actives.
Réduction des déplacements professionnels
Un des succès majeurs de cette transition a été la réduction des déplacements professionnels, qui représentent 6% du BEGES. Les déplacements aériens, considérés comme les plus polluants, ont chuté de moitié entre 2019 et 2022. Cette baisse résulte de plusieurs facteurs, notamment les restrictions dues à la pandémie de Covid-19, mais aussi un changement institutionnel vers des solutions de visioconférence et un recours accru au train pour les trajets européens. Ces transformations dans les pratiques de déplacement témoignent d’un changement de paradigme au sein du CNRS, plaçant la durabilité au cœur de ses missions.
La biodiversité, un enjeu fondamental
Le bilan carbone ne doit pas occulter un autre aspect essentiel : la biodiversité. Bien que difficile à quantifier, l’impact sur la biodiversité est tout aussi crucial que les émissions de GES. Comme le note Blandine de Geyer, référente nationale au développement durable du CNRS, il est primordial d’intégrer l’impact sur la biodiversité dans le cadre d’une évaluation environnementale complète. Le CNRS s’efforce de développer une approche systémique qui intègre également la question de l’eau et des déchets plastiques, qui demeurent largement sous-évalués dans le bilan carbone.
Perspectives d’avenir et opportunités stratégiques
En conclusion, le CNRS, à travers ce second bilan carbone, démontre son engagement envers la transition environnementale. En cherchant à équilibrer l’optimisation de son bilan carbone avec le maintien de ses standards de recherche, l’organisme explore également de nouvelles avenues afin de répondre aux enjeux environnementaux de manière stratégique. Stéphane Guillot, délégué scientifique au développement durable et aux risques, souligne que la transition environnementale ne doit pas être perçue comme une contrainte, mais comme une opportunité stratégique pour l’institution. Alors que le CNRS s’engage à établir un référentiel spécifique aux activités de recherche, les efforts doivent se poursuivre afin de garantir une réduction effective et mesurable de son empreinte environnementale.
Pour plus d’informations sur la publication du bilan carbone, vous pouvez consulter les articles suivants : Le CNRS évalue son impact écologique avec son second bilan carbone et Le CNRS élabore son second bilan énergétique carbone.
Dans la continuité de ses objectifs, le CNRS explorera également les moyens d’améliorer la gestion de ses achats et de valoriser les pratiques écoresponsables. Une approche innovante dans le cadre de la transition environnementale constitue un défi à la fois ambitieux et nécessaire pour assurer la pérennité de ses recherches tout en minimisant son empreinte globale. Pour ceux intéressés par les stratégies d’optimisation du bilan carbone, le site de l’APCC propose également des ressources : Transformer le bilan carbone en un levier stratégique.
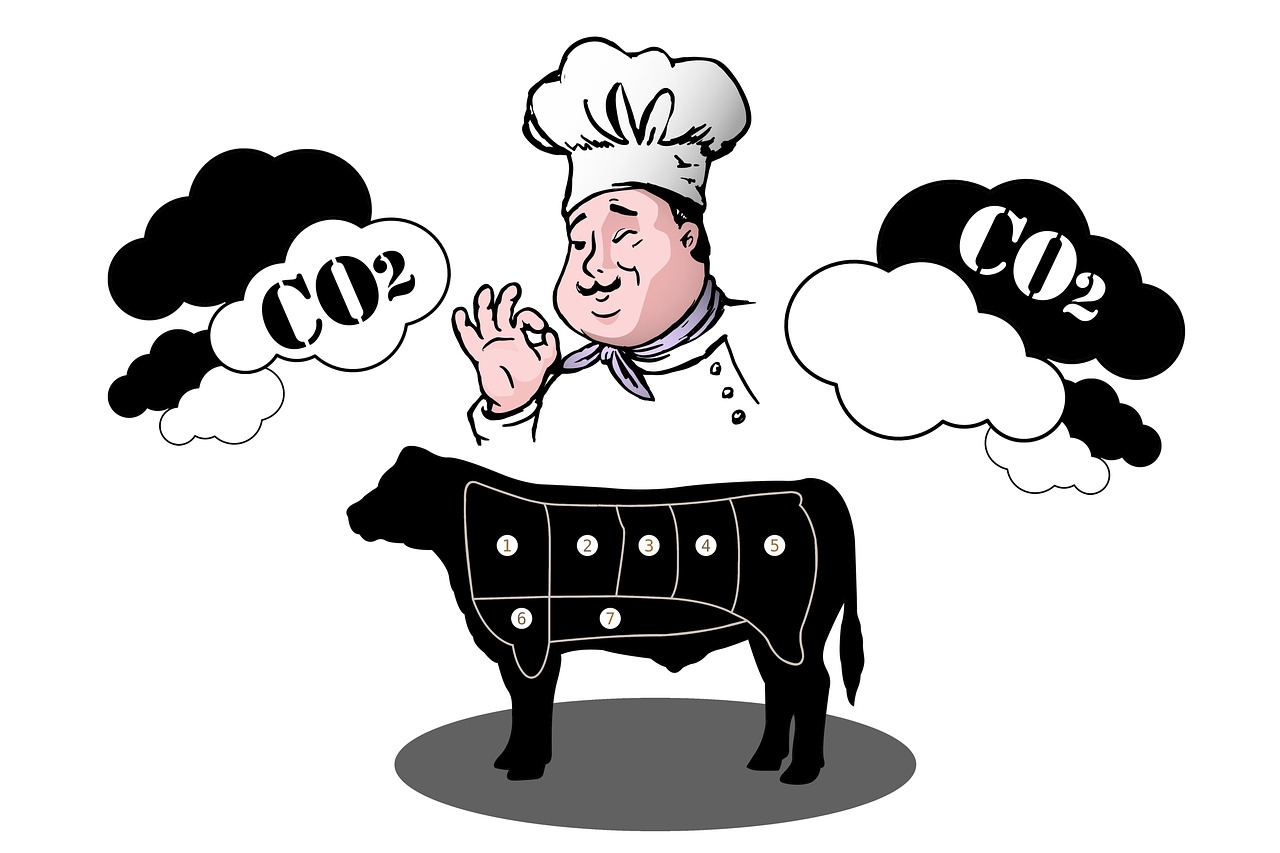
Témoignages sur le second bilan carbone du CNRS
Le CNRS a récemment publié son second bilan carbone pour l’année 2022, une démarche cruciale dans l’évaluation de son impact environnemental. Selon un chercheur engagé, « ce bilan est essentiel pour comprendre les émissions de gaz à effet de serre générées par nos activités. Il met en lumière les progrès réalisés et les axes d’amélioration à envisager ». Cette prise de conscience au sein de l’organisme de recherche témoigne d’une volonté d’aligner son fonctionnement sur des objectifs de durabilité.
Un autre acteur du CNRS partage son expérience : « Depuis le premier bilan en 2019, nous avons observé un changement significatif dans nos pratiques. Nous avons entrepris de réduire notre empreinte environnementale par des actions concrètes, notamment grâce à la transition bas carbone et à l’optimisation des ressources ». Grâce à des efforts collectifs, il est possible de constater des baisses d’émissions dans plusieurs secteurs.
Un membre de l’équipe responsable de l’évaluation souligne les défis rencontrés : « Bien que le bilan mette en avant les succès, il est primordial de reconnaître les biais méthodologiques. Par exemple, notre méthode de calcul des achats n’est pas encore suffisamment précise, ce qui complique l’estimation des émissions directement liées à ces derniers. Nous travaillons activement à affiner nos méthodes de calcul pour avoir des résultats plus justes ».
Une coordinatrice de projet se dit optimiste face à l’avenir : « Je crois que le second bilan carbone constitue une opportunité d’engager l’ensemble des départements vers une approche d’achat responsable. En intégrant des critères environnementaux, nous pouvons faire évoluer notre culture scientifique vers un modèle durable ». Chaque membre de l’équipe ressent cette responsabilité croissante vis-à-vis de l’environnement.
Enfin, un expert en développement durable au CNRS mentionne : « La publication de ce bilan carbone est une étape clé pour guider notre futur. Au-delà de la simple évaluation, nous devons comprendre notre rôle dans la préservation de la biodiversité et la réduction de notre impact global. Des initiatives autour de l’eau et des déchets doivent également être mises en avant pour compléter notre démarche environnementale ».




