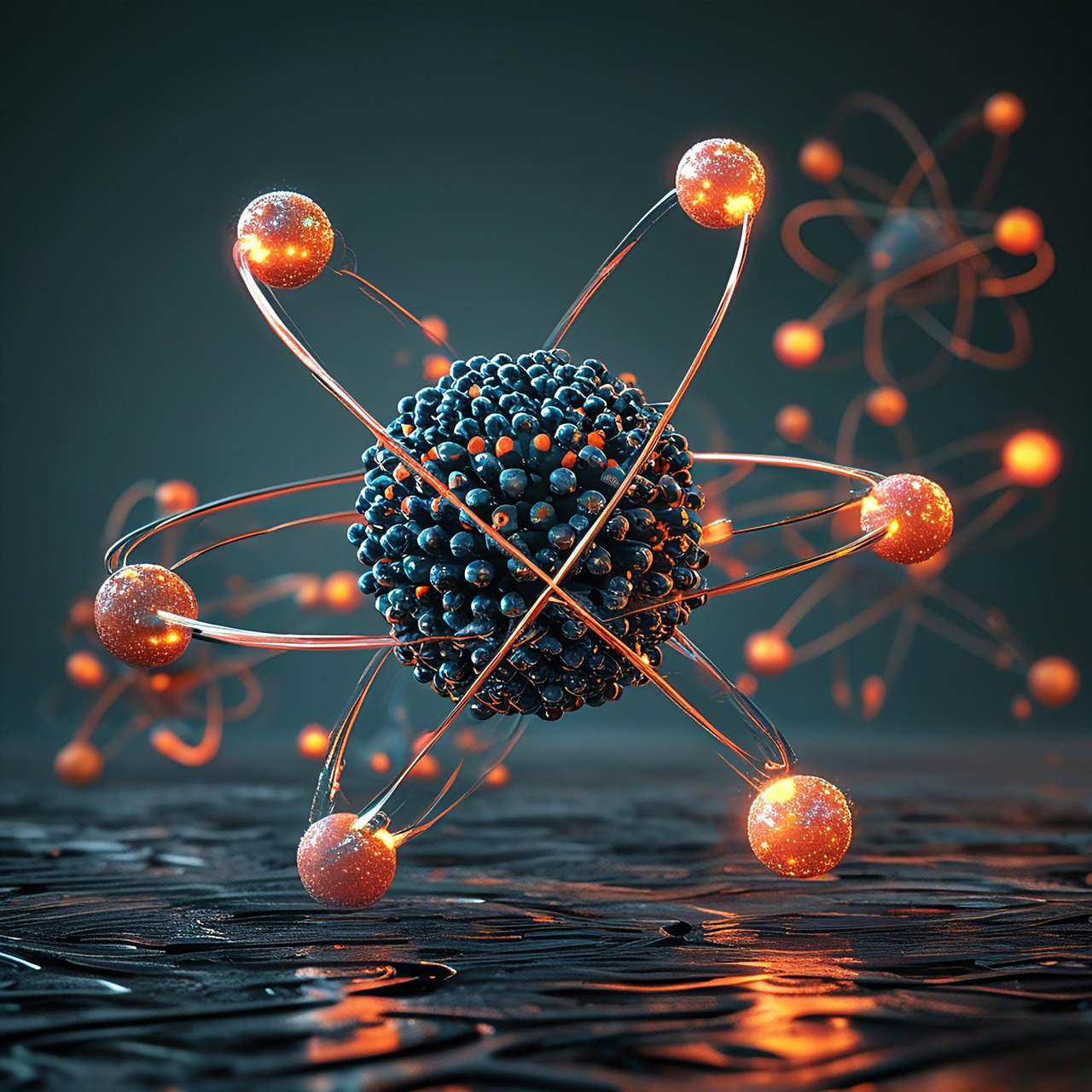|
EN BREF
|
Le ministère de la Culture a entouré une étude exhaustive sur l’empreinte carbone de la création artistique, mettant en lumière les défis du secteur. Réalisée avec le soutien du cabinet PwC, cette initiative a pour but de comprendre l’impact environnemental des pratiques artistiques. Les résultats indiquent que les émissions de gaz à effet de serre (GES) des activités subventionnées atteignent 400 kilotonnes de CO²e par an, représentant 5% des émissions totales du secteur. L’étude révèle également que l’ensemble de la création artistique pourrait générer jusqu’à 8,5 millions de tonnes de CO²e par an. Les postes d’émission majeurs, tels que la mobilité des spectateurs et les achats de biens, soulignent la nécessité d’une transformation écologique. Cette évaluation, qui inclut des contributions d’associations professionnelles, vise à élaborer des plans d’action collectifs pour réduire l’empreinte carbone à travers le secteur.
Récemment, une étude novatrice a été réalisée pour évaluer l’empreinte carbone dans le secteur de la création artistique. Cette initiative, pilotée par le ministère de la Culture, s’inscrit dans un objectif plus large de prise de conscience écologique et de mise en œuvre de pratiques durables. L’étude met en lumière les enjeux environnementaux liés aux activités artistiques, en intégrant une analyse approfondie des émissions de gaz à effet de serre (GES) ainsi qu’une réflexion sur les manières d’optimiser les ressources et réduire l’impact écologique des productions artistiques.
Les fondements de l’étude sur l’empreinte carbone
L’étude concernant l’empreinte carbone de la création artistique a été initiée par la direction générale de la création artistique dans le cadre du guide d’orientation et d’inspiration du ministère de la Culture. Il s’agit d’une première analyse systématique visant à mesurer l’impact environnemental des pratiques artistiques en France.
La mise en œuvre de cette évaluation a été confiée au cabinet PwC (Price Waterhouse Coopers), en collaboration avec le Département des études, de la prospective, des statistiques et de la documentation (DEPS-DOC) du ministère. Cette synergie entre des experts en finance et des acteurs culturels a permis de recueillir des données essentielles concernant les référentiels carbone des structures artistiques subventionnées.
Un travail collectif et inclusif
Cette étude s’est bâtie sur une dynamique collaborative au sein du secteur, impliquant plusieurs associations professionnelles de 11 labels ainsi que 5 réseaux créatifs, qui incluent des équipes artistiques et des festivals. Cette approche collective a permis non seulement de partager des connaissances, mais également de développer une compréhension commune des enjeux liés à l’énergie et au climat.
Le cadre de cette démarche a permis de former les équipes aux défis énergétique et climatique, abordant les principales actions à mener pour réduire leur empreinte, telles que l’écoconception, la mobilité durable et l’utilisation d’énergies renouvelables. Au total, plus de 100 bilans carbone ont été réalisés, bâtissant une base solide pour la mise en place de plans d’action adaptés aux spécificités de chaque réseau.
L’impact significatif du secteur artistique
Les résultats de cette étude dévoilent des éléments frappants concernant l’empreinte carbone du secteur de la création artistique. En effet, les émissions de GES de ce secteur subventionné sont évaluées à environ 400 kilotonnes de CO2e par an, représentant 5% des émissions globales du secteur de la création artistique. Ces chiffres incluent diverses activités, couvrant le spectacle vivant, les arts visuels et l’enseignement supérieur de la création artistique.
En extrapolant ces données, l’ensemble de la création artistique en France aurait une empreinte carbone estimée à 8,5 millions de tonnes de CO2e par an, ce qui représente 1,3% de l’empreinte nationale. À titre de comparaison, le transport aérien intérieur représente 0,7%, le numérique 4,4% et le tourisme 15%. Ces chiffres illustrent non seulement le poids du secteur de la création, mais aussi les marges de manœuvre significatives dans une recherche de solutions durables.
Les principaux postes d’émissions dans le spectacle vivant
L’étude approfondie des secteurs du spectacle vivant et des arts visuels a mis à jour les principaux postes d’émissions qui décrivent les diverses origines des GES. Pour le spectacle vivant, il a été constaté que la mobilité des spectateurs représente le premier poste d’émission, avec une part de 38% des émissions du secteur, un chiffre qui se révèle inférieur aux attentes initiales.
En outre, les achats constituent un facteur d’émission significatif, avec une part de 25% liée à l’acquisition de biens et services, comme les décors, costumes et accessoires. Les achats d’actifs amortissables tels que véhicules, bâtiments et équipements représentent aussi 10% des émissions. Ce constat souligne l’importance d’une réflexion sur les pratiques d’achat et de transport au sein de ce secteur.
Les principaux postes d’émissions dans les arts visuels
Pour le domaine des arts visuels, la situation est similaire. La mobilité des visiteurs s’élève à 65% des émissions, ce qui en fait le principal poste d’émission. Toutefois, les achats constituent également un aspect non négligeable, représentant 19% au total. Cela souligne l’interconnexion entre les activités des arts visuels et leur impact environnemental.
Des initiatives innovantes pour un avenir durable
Face à ce bilan préoccupant, des initiatives se multiplient pour œuvrer vers un avenir plus durable dans le secteur artistique. Des projets comme ceux développés par le collectif 17h25, réunissant des institutions de renom comme le Théâtre du Châtelet, l’Opéra de Paris et le festival d’Aix-en-Provence, visent à standardiser les châssis de décors afin de minimiser le transport lors des tournées. Cette démarche est un exemple concret de coopération visant à réduire l’impact environnemental.
De plus, en 2025, le festival d’Avignon et le festival d’Avignon Off prévoient d’acheminer les décors par voie ferroviaire. Cette initiative, qui concerne 150 spectacles, représente un volume considérable de matières à transporter, soulignant la nécessité d’adopter des solutions logistiques plus durables.
Une vision vers la neutralité carbone
Les résultats de cette étude ont été rendus publics lors du Festival d’Avignon, marquant une étape importante dans la prise de conscience collective du secteur artistique. En identifiant les leviers de réduction de l’empreinte carbone, il est possible d’inscrire le domaine de la création artistique dans une trajectoire de réduction des émissions, alignée avec l’objectif européen de neutralité carbone d’ici 2050.
Les résultats détaillés concernant les arts visuels et l’enseignement supérieur seront présentés d’ici 2025, et l’ensemble de l’étude sera accessible sur le site du ministère de la Culture à l’automne de la même année. Cette transparence est essentielle pour une bonne compréhension des enjeux environnementaux et encouragera le secteur à évoluer vers des pratiques plus durables.
Perspectives futures et politiques publiques
Dans le cadre des politiques publiques, les résultats de cette étude contribueront à définir des orientions claires pour la transformation écologique de la création artistique. En affinant les politiques publiques, il sera possible d’optimiser les leviers de réduction des émissions de GES, favorisant ainsi une transition vers une création artistique plus durable.
Cette évolution s’inscrit dans la continuité d’un plan d’action plus large pour la transformation écologique du secteur culturel, visant à intégrer les préoccupations environnementales dans chaque phase de la création artistique. Cela représente un changement de culture indispensable pour faire face aux défis contemporains tout en garantissant la richesse et la diversité de l’art.
Cette première étude sur le bilan carbone dans le domaine de la création artistique représente une avancée significative pour comprendre l’impact environnemental des pratiques artistiques et forger un futur plus responsable et durable. En réunissant les acteurs clés du secteur, en partageant les données et en développant des solutions collectives, il devient possible de construire un écosystème artistique qui soit à la fois respectueux de l’environnement et riche en créativité.

Le secteur de la création artistique a longtemps été perçu comme déconnecté des préoccupations environnementales. Cependant, la nouvelle étude sur le bilan carbone de ce secteur révèle une réalité préoccupante qui incite à une profonde réflexion. Un membre de la communauté artistique partage : « Il est essentiel de comprendre notre impact sur la planète. Cette étude nous ouvre les yeux sur des enjeux que nous ne pourrions plus ignorer. »
Un directeur de festival ajoute : « Avant de prendre connaissance des résultats, je doutais de la pertinence de mesurer notre empreinte carbone. Aujourd’hui, je réalise que chaque décision, qu’il s’agisse de transport ou de choix d’énergie, a des répercussions sur l’environnement. » Cette prise de conscience collective montre que la création artistique peut devenir un levier d’action face aux enjeux climatiques.
Un artiste plasticien qui s’est engagé dans une démarche plus écoresponsable souligne : « Je commence à intégrer des matériaux durables dans mon travail, mais je me rends compte que c’est un véritable défi logistique. L’étude nous donne un cadre pour réfléchir à l’ensemble de notre pratique artistique sous l’angle de la durabilité. »
Du côté des institutions, un responsable d’une école d’art témoigne : « Former nos étudiants à la question du bilan carbone est devenu une priorité. Il ne s’agit plus seulement d’être créatif, mais aussi d’être responsable. Nous voulons les préparer à des pratiques artistiques qui respectent l’environnement. »
Les résultats de cette étude dévoilent aussi des pistes concrètes. Un membre d’une association professionnelle confie : « En collaborant avec d’autres acteurs de la création, nous pouvons développer des bonnes pratiques, que ce soit par l’écoconception ou en favorisant des solutions de mobilité durable. » Cela témoigne d’une volonté de mutualiser les efforts pour réduire l’empreinte écologique du secteur.
Enfin, un spécialiste du développement durable dans le secteur culturel conclut : « Cette étude est un véritable appel à l’action. Elle démontre que le secteur artistique a un rôle à jouer dans la lutte contre le changement climatique. Grâce à des analyses comme celle-ci, nous avons l’opportunité de transformer notre approche et de faire de la création un moteur d’espoir et de changement. »