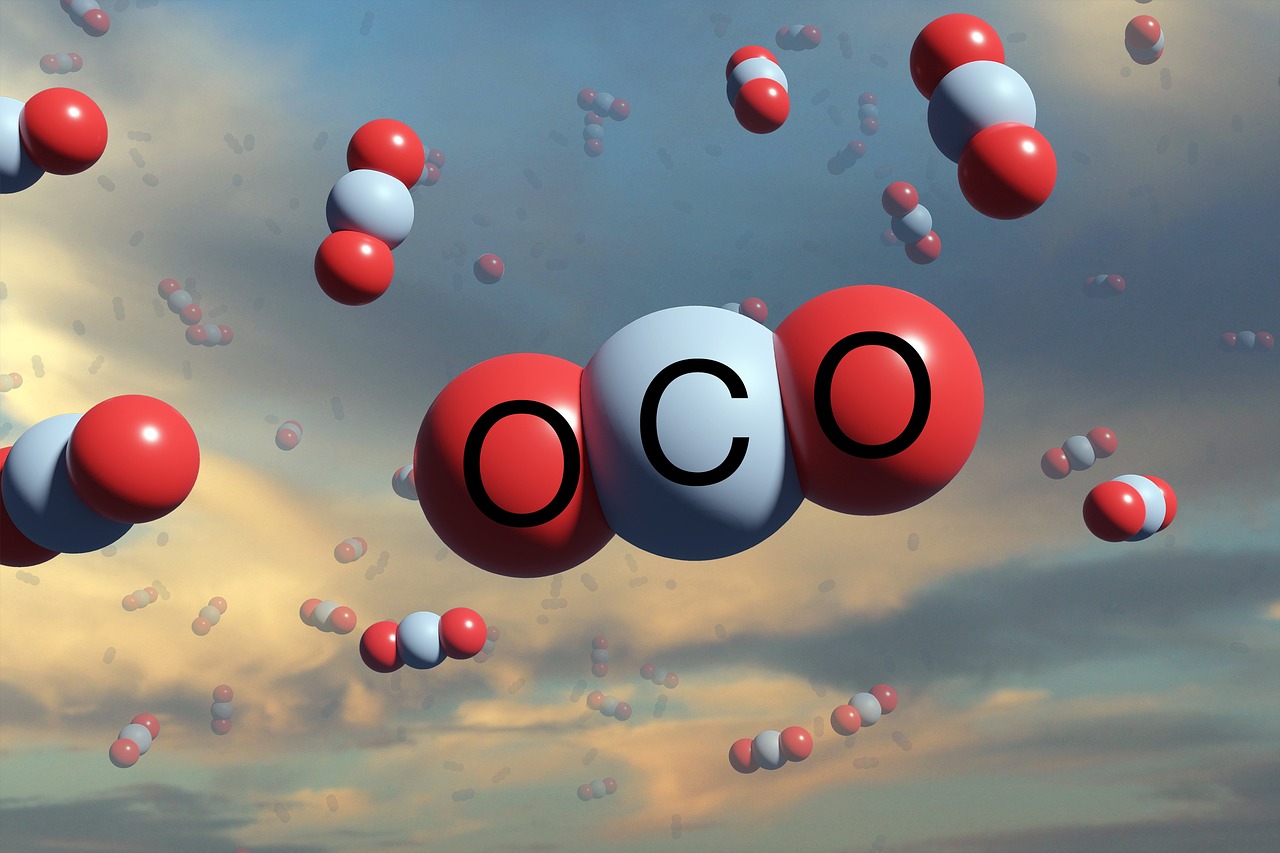|
EN BREF
|
La ferme Craven, située en Montérégie, est l’une des 20 fermes laitières québécoises qui participent au projet innovant « Lait carboneutre », visant à réduire l’empreinte carbone de la production laitière. Avec un troupeau de 96 vaches qui génèrent une importante quantité de méthane, la ferme a émis 1253 tonnes de CO2 en 2022, équivalent aux émissions de plusieurs vols ou voitures. Malgré cela, le diagnostic a montré que son empreinte carbone est en dessous des moyennes, atteignant 0,89 kg d’équivalent CO2 par kg de lait, ce qui est inférieur à la moyenne du Québec.
Le projet, soutenu par Agriculture et Agroalimentaire Canada, fait appel à des méthodes collaboratives entre scientifiques et agriculteurs pour améliorer les pratiques agricoles et viser une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre. Un des principaux axes d’action repose sur la gestion du fumier, où la ferme Craven a opté pour une litière compostée, permettant une meilleure gestion des déjections animales et réduisant significativement les émissions. Ce modèle servira de référence pour d’autres producteurs, avec un bilan carbone régulier pour ajuster les pratiques et mener vers une production laitière durable.
La question de la durabilité dans l’industrie laitière est devenue cruciale en raison des enjeux environnementaux croissants. De nombreuses fermes s’engagent dans des projets innovants pour réduire leur empreinte carbone et adopter des pratiques d’agriculture durable. Dans ce dossier, nous explorerons comment des initiatives telles que le projet « Lait carboneutre » sont mises en place pour guider les producteurs vers une production de lait à empreinte carbone neutre. Nous allons examiner les différentes étapes du processus allant du bilan carbone aux solutions proposées, tout en présentant des exemples concrets de fermes engagées dans cette transition.
Le cadre du projet « Lait carboneutre »
Le projet « Lait carboneutre » a été lancé avec l’objectif ambitieux de réunir les agriculteurs et les scientifiques pour développer des méthodes à faible émission de gaz à effet de serre (GES). À travers une approche de cocréation, les producteurs de lait ont la possibilité de partager leurs préoccupations et de collaborer avec des experts pour trouver des solutions adaptées à leurs conditions spécifiques. Ce projet est également perçu comme un moyen d’accompagner les agriculteurs dans leur transition vers des pratiques plus écologiques.
Comprendre l’impact environnemental de la production laitière
La production laitière contribue de façon significative aux émissions mondiales de GES. Parmi ces émissions, le méthane provenant de la digestion des vaches représente un des plus grands défis. En fait, ce gaz à effet de serre est beaucoup plus puissant que le dioxyde de carbone, contribuant à un réchauffement climatique accentué. En 2022, certaines fermes laitières ont été évaluées, révélant que la ferme Craven en Montérégie avait une empreinte carbone d’environ 0,89 kg d’équivalent CO2 par kilogramme de lait produit, ce qui est inférieur à la moyenne du Québec.
Évaluation de l’empreinte carbone : un bilan nécessaire
Évaluer l’empreinte carbone d’une ferme est la première étape cruciale pour réduire son impact environnemental. Cela implique d’analyser toutes les émissions de GES associées aux différentes activités de la ferme. Des facteurs comme la fermentation entérique, le fumier et la gestion des champs doivent être pris en compte. Par exemple, la ferme Craven a pu démontrer que ses émissions provenant de la gestion des déjections étaient nettement inférieures à celles de ses homologues, grâce à son utilisation d’une litière compostée qui limite les émissions de méthane.
Les étapes vers une empreinte carbone neutre
Le diagnostic initial
Un diagnostic complet est nécessaire pour comprendre les sources d’émissions sur la ferme. Cela demande un regard attentif sur les pratiques d’alimentation des vaches, la gestion des déjections, ainsi que les méthodes de culture utilisées sur l’exploitation. Le résultat de cette analyse fournit un aperçu des points à améliorer et des meilleures pratiques à adopter.
Optimisation des pratiques agricoles
Après avoir identifié les émissions, la prochaine étape consiste à introduire des pratiques visant à réduire cette empreinte. Cela peut inclure l’amélioration de la nutrition des vaches pour diminuer la production de méthane, ou encore la mise en œuvre de systèmes de compostage pour gérer efficacement les déjections. Les agriculteurs peuvent aussi tourner leur attention vers des pratiques de séquestration du carbone, comme la rotation des cultures et l’utilisation de couverts végétaux.
Formation et sensibilisation des agriculteurs
Pour atteindre ces objectifs, il est essentiel de former et de sensibiliser les agriculteurs. Des programmes de formation peuvent être mis en place pour les aider à comprendre l’importance de leurs choix en matière de pratiques agricoles et à leur fournir les outils nécessaires pour réduire les émissions. Dans le cadre du projet « Lait carboneutre », des conférences et des ateliers sont organisés régulièrement afin de partager les résultats des recherches et des succès des producteurs.
Exemples de fermes engagées dans la transition
De nombreuses fermes au Québec et ailleurs prennent des mesures significatives pour réduire leur empreinte carbone. Par exemple, la ferme Craven utilise des systèmes de litière compostée qui améliorent non seulement la gestion des déchets, mais réduisent également les émissions de méthane. D’autres fermes explorent des méthodes comme l’alimentation additionnelle en algues, qui pourrait réduire la production de méthane par les animaux.
Les défis à surmonter
Malgré les avancées réalisées dans le cadre de projets tels que « Lait carboneutre », plusieurs défis demeurent. Les producteurs de lait doivent composer avec les fluctuations des marchés, les contraintes économiques et la nécessité d’une transition stratégique vers des pratiques durables. Ces défis peuvent freiner les progrès, mais ils ne sont pas insurmontables. Les agriculteurs souhaitent souvent faire une différence et mettent tout en œuvre pour répondre à cette exigence environnementale croissante.
Les politiques publiques et leur rôle
Les gouvernements jouent également un rôle crucial dans la promotion de pratiques d’agriculture durable. Des incitations financières, des subventions pour les recherches et des politiques favorisant l’innovation dans l’agriculture peuvent aider les producteurs à faire le saut vers une production plus durable. Par exemple, des programmes comme celui de l’USDA aux États-Unis ou des initiatives européennes visant la transition écologique offrent des modèles de soutien aux agriculteurs.
Technologies innovantes pour une agriculture durable
Les avancées technologiques offrent de nouvelles perspectives pour réduire l’empreinte carbone de la production laitière. Des outils comme les calculatrices d’empreinte carbone permettent aux fermes d’évaluer leur impact et de suivre leurs progrès au fil du temps. Par ailleurs, l’utilisation de drones pour surveiller la santé des cultures et optimiser l’utilisation des ressources peut contribuer à rendre les activités agricoles moins polluantes.
Conclusion et perspectives d’avenir
La quête d’une production de lait à empreinte carbone neutre est un défi ambitieux mais essentiel pour assurer la durabilité de l’industrie laitière. Par le biais de projets, de pratiques d’agriculture durable et de collaboration entre agriculteurs, scientifiques et gouvernements, il est possible de réduire les émissions de GES et de travailler vers un avenir plus respectueux de l’environnement. Cette transition exigera des efforts continus, mais elle constitue un objectif primordial pour la santé de notre planète.

Témoignages : Vers une production de lait à empreinte carbone neutre
« J’ai eu la chance de rejoindre ce projet innovant sur le lait carboneutre. En tant que productrice laitière, je suis motivée par l’idée de réduire notre empreinte carbone. Chaque petite action compte, pour nous mais aussi pour les générations futures. Nous avons commencé à tester de nouvelles pratiques comme l’utilisation de litière compostée, ce qui a déjà montré des résultats encourageants. S’engager dans cette voie, c’est devenir un acteur du changement, et c’est véritablement inspirant. »
« Participer au laboratoire vivant Lait carboneutre est un véritable défi. Nous comprenons mieux l’impact de nos choix quotidiens sur l’environnement. J’ai remarqué à quel point mes collègues, surtout les jeunes, sont prêts à adopter des techniques modernes afin de diminuer notre empreinte de manière significative. Nous avons des outils à notre disposition, et il est temps de s’en servir pour construire un avenir plus durable. »
« Au départ, j’étais préoccupé par l’idée de mesurer l’empreinte carbone de mes activités. Je craignais de découvrir des chiffres alarmants. À ma grande surprise, notre ferme s’avère moins polluante que la moyenne. Cela prouve que nous avons déjà mis en place de bonnes pratiques. Nous devons maintenant intensifier nos efforts pour atteindre une neutralité carbone. »
« La gestion du fumier est un gros sujet. J’ai toujours cru que nous pouvions faire mieux. Grâce au compostage, nous avons réduit les émissions de méthane de manière significative. Non seulement cela, mais nous avons aussi augmenté la qualité de notre sol, ce qui améliore la santé de mes vaches. C’est un cercle vertueux que j’encourage mes pairs à rejoindre. »
« Nous avons élaboré un plan d’action sur cinq ans pour rendre notre production laitière neutre en carbone. Cela prendra du temps, mais chaque étape nous rapproche un peu plus de cet objectif. Je suis fier de faire partie d’une initiative qui fait la différence à la fois localement et globalement. C’est une responsabilité que nous avons envers notre planète et nos consommateurs. »
« Le soutien des chercheurs et experts dans ce projet nous apporte une vision nouvelle sur l’agriculture durable. Les outils qu’ils nous fournissent sont précieux pour l’avenir de notre industrie. Cela me rassure de savoir que nous avons l’expertise nécessaire pour transformer notre modèle de production. Nous sommes sur la bonne voie, et avec une collaboration constante, nous pouvons réaliser de grandes choses. »